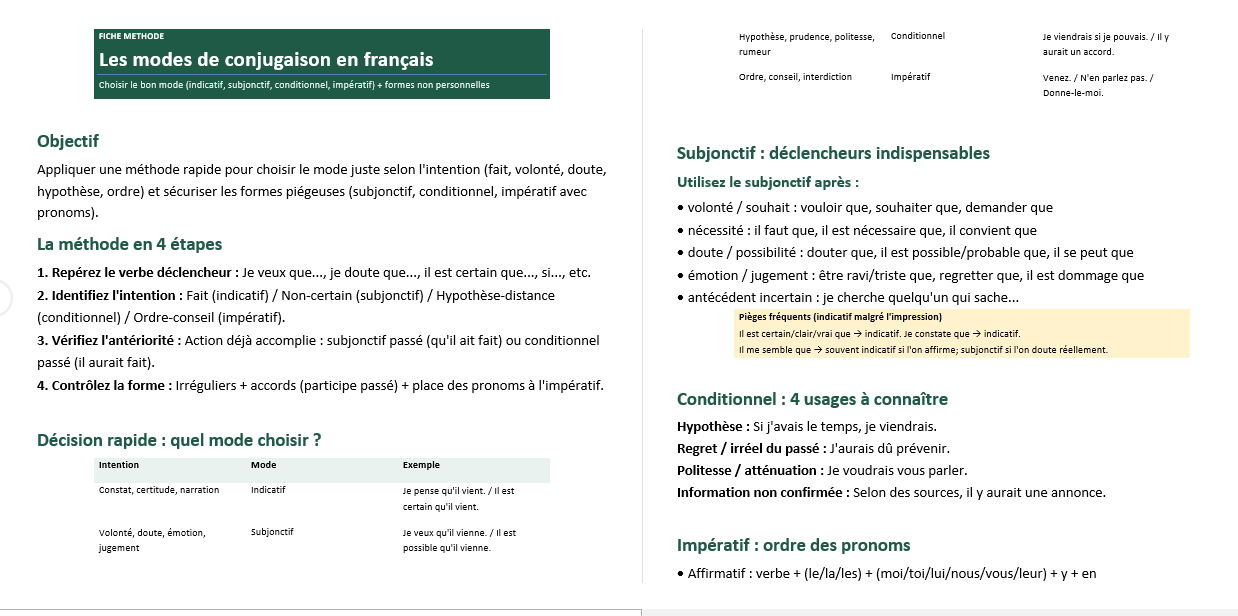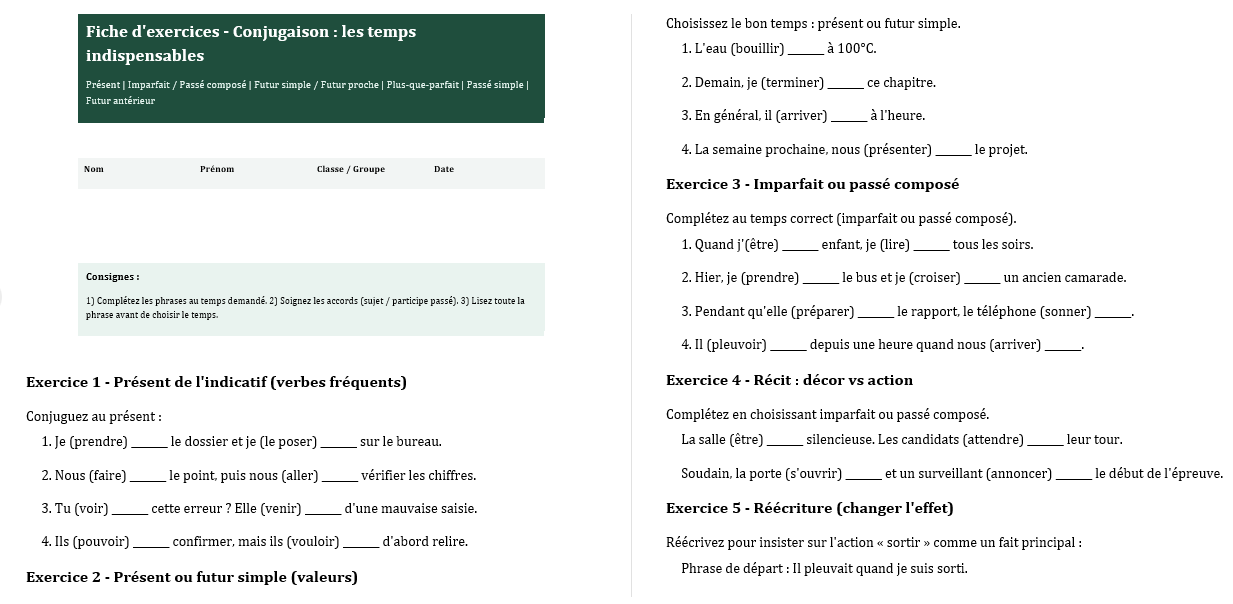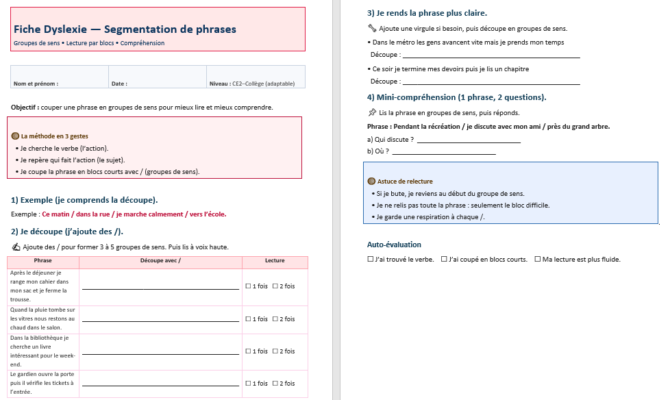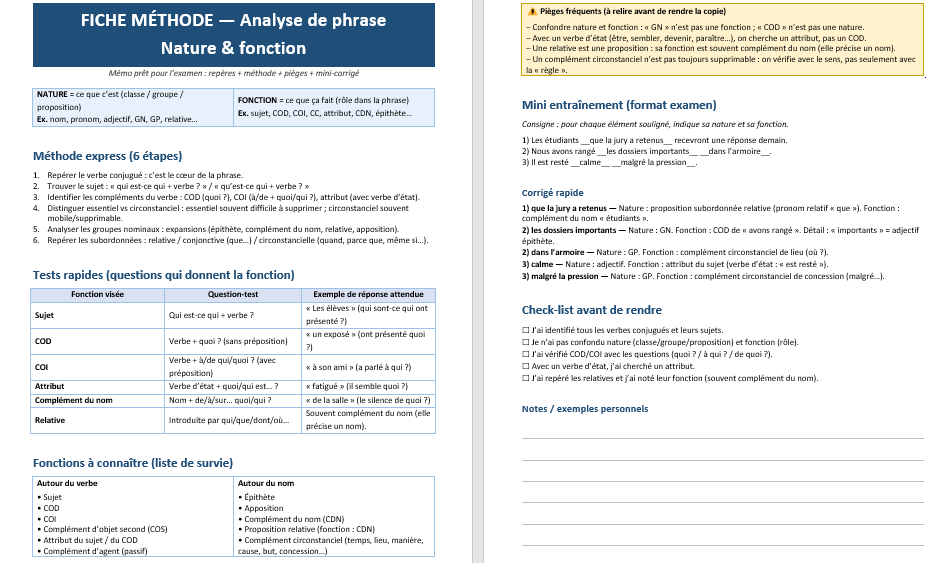⚖️ Dissertation de Droit Administratif : Méthodologie Complète
Recommandés
Cet article propose un guide méthodologique complet, étape par étape, pour réussir une dissertation en droit administratif.
La dissertation juridique est un exercice classique mais redoutable des études de droit. En droit administratif, elle vise à tester la capacité de l’étudiant à raisonner juridiquement à partir d’un sujet général, en mobilisant le droit positif, la jurisprudence, et la doctrine, le tout en suivant une méthode rigoureuse.
1. Comprendre le sujet
La première étape est l’analyse du sujet. Il ne s’agit pas d’un simple thème à illustrer, mais d’un problème juridique à identifier.
🔎 Que faire :
- Définir chaque terme du sujet
- Reformuler le sujet sous forme de question problématisée
- Éviter les hors-sujets en restant centré sur le droit administratif
Exemple : La légalité des actes administratifs suffit-elle à assurer leur légitimité ?
➤ Problématique : La conformité juridique des actes suffit-elle à garantir leur acceptabilité sociale et politique ?
🧱 2. Élaborer un plan structuré
Le plan doit être juridique, logique et progressif. Il s’agit d’examiner deux aspects du sujet, souvent complémentaires ou opposés.
📐 Types de plans possibles :
- Plan dialectique (thèse / antithèse / dépassement)
- Plan analytique (causes / effets)
- Plan fonctionnel (régime / limites)
Exemple de plan pour le sujet ci-dessus :
- I. La légalité, fondement indispensable de l’action administrative
- II. Mais une légitimité qui dépasse la simple conformité au droit
3. Rédiger l’introduction
L’introduction est essentielle. Elle doit être claire, concise, et suivre une structure codifiée.
Structure idéale :
- Accroche (actualité, jurisprudence, évolution historique…)
- Définition des termes clés
- Problématique
- Annonce du plan
Exemple d’accroche : Depuis la Révolution française, l’administration est soumise au principe de légalité, pierre angulaire de l’État de droit…
4. Développement argumenté
Chaque partie doit contenir :
- Une idée directrice claire
- Des arguments juridiques solides
- Des exemples précis : textes, jurisprudence, décisions administratives
- Des transitions fluides pour la cohérence
Outils mobilisables :
- Code des relations entre le public et l’administration
- Grands arrêts du Conseil d’État (Benjamin, Ternon, Nicolo…)
- Principes généraux du droit
5. La conclusion
Elle doit :
- Synthétiser les apports de la réflexion
- Répondre clairement à la problématique
- Ouvrir sur un enjeu, une réforme ou une question connexe (facultatif)
Exemple de conclusion : La légalité est nécessaire, mais pas toujours suffisante pour garantir la légitimité d’une décision administrative. Une administration transparente, participative et soucieuse de l’intérêt général renforce cette légitimité au-delà du droit.
Conseils pratiques
- Toujours rédiger au brouillon le plan détaillé
- Ne jamais réciter le cours : adapter les connaissances au sujet
- Soigner la présentation (titres visibles, alinéas, style juridique)
- Respecter le temps imparti : 1h pour le plan + 2h pour la rédaction (approximativement)
La dissertation en droit administratif est un exercice d’analyse juridique approfondie, exigeant méthode et rigueur. Elle ne récompense pas la récitation, mais la capacité à problématiser, structurer et démontrer.
🔧 Outils Pratiques pour Réussir une Dissertation en Droit Administratif
6. Identifier les types de sujets fréquents
En droit administratif, les sujets suivent souvent certaines logiques récurrentes. Les connaître permet d’anticiper les angles de traitement.
🔹 Les grandes notions à débat :
- La légalité / la légitimité
- Le service public
- Le pouvoir réglementaire
- L’intérêt général
- Le rôle du juge administratif
🔹 Les sujets de type évolution :
- L’évolution de la responsabilité de l’administration
- Le renforcement du contrôle juridictionnel
- L’influence du droit européen sur le droit administratif français
🔹 Les sujets de type confrontation :
- L’ordre public face aux libertés fondamentales
- Le principe de précaution contre la liberté d’entreprendre
- L’intérêt général et le droit de propriété
7. Jurisprudences essentielles à connaître
Voici quelques arrêts incontournables que l’on retrouve souvent comme illustration ou point de départ d’une dissertation :
| Arrêt | Apport juridique |
|---|---|
| CE, 1933, Benjamin | Proportionnalité des mesures de police administrative |
| CE, 1950, Dehaene | Reconnaissance du droit de grève dans le service public |
| CE, 2001, Ternon | Retrait des actes administratifs créateurs de droit |
| CE, 2004, Hallal | Substitution de motifs dans un acte administratif |
| CE, 2009, Mme Perreux | Invocabilité des directives européennes non transposées |
Conseil : Toujours contextualiser la jurisprudence dans le raisonnement, et non simplement la citer.
🗂️ 8. Modèle de fiche d’analyse pour s’entraîner
Voici un petit canevas à utiliser pour préparer n’importe quelle dissertation :
Sujet :
Définitions des termes :
Problématique :
Plan proposé :
- I. …
- II. …
Jurisprudences mobilisables :
Risques de hors sujet ou pièges :
Lien avec l’actualité / ouverture possible :
🧠 Tu peux l’utiliser comme fiche de préparation rapide avant les examens ou pour organiser tes révisions thématiques.
📋 9. Les erreurs fréquentes à éviter
- ❌ Récitation du cours sans adaptation au sujet
- ❌ Oubli de la problématique ou plan déséquilibré
- ❌ Absence de références précises (jurisprudence ou texte)
- ❌ Développement descriptif ou narratif au lieu d’être argumentatif
- ❌ Introduction floue ou trop longue
10. Derniers conseils
- Entraîne-toi régulièrement à faire des plans sur des sujets différents
- Constitue une boîte à outils jurisprudentielle (fiche par thème)
- Lis des copies corrigées ou modèles commentés
- Reste synthétique et évite le remplissage inutile : une copie bien structurée vaut mieux qu’une copie longue

Ci-après deux dissertations types complètes en droit administratif, rédigées selon la méthodologie classique (introduction, développement structuré, conclusion), avec références juridiques et raisonnements clairs.
⚖️ Dissertation type n°1 : La légalité de l’action administrative garantit-elle sa légitimité ?
📝 Introduction
Accroche : Dans un État de droit, l’administration est tenue de respecter les règles juridiques dans toutes ses décisions. Cependant, certaines décisions, bien que légales, suscitent la désapprobation des citoyens.
Définitions :
- La légalité administrative signifie la conformité de l’action de l’administration aux normes juridiques.
- La légitimité, quant à elle, relève d’un registre plus large : acceptabilité sociale, morale, politique.
Problématique : Peut-on considérer qu’une décision administrative est toujours légitime dès lors qu’elle est légale ? Ou faut-il aller au-delà de la stricte conformité juridique pour satisfaire les exigences démocratiques ?
Annonce du plan : Si la légalité est la base de l’action administrative (I), elle n’est pas toujours suffisante pour fonder sa légitimité dans la société (II).
✅ I. La légalité, fondement incontournable de l’action administrative
A. Une exigence constitutionnelle et juridique
- Le principe de légalité découle de l’article 1er de la Constitution.
- CE, 1918, Heyriès et CE, 1933, Benjamin : toute décision doit respecter la hiérarchie des normes et les droits fondamentaux.
B. La garantie de la sécurité juridique et de la transparence
- L’encadrement légal des décisions évite l’arbitraire.
- Le contrôle du juge administratif garantit la régularité des actes.
⚠️ II. Une légalité parfois insuffisante pour asseoir la légitimité
A. Des décisions légales mais contestées dans leur acceptabilité
- Ex : fermetures d’hôpitaux, restrictions de manifestations ou expropriations légalement fondées mais socialement mal perçues.
- Légalité ≠ adhésion citoyenne.
B. Vers une administration plus participative et transparente
- Loi ESSOC (2018) : administration de confiance.
- Démarches participatives, concertations et évaluations renforcent la légitimité démocratique.
🧾 Conclusion
Si la légalité est une condition indispensable à toute décision administrative, elle ne garantit pas à elle seule sa légitimité. L’administration contemporaine doit allier rigueur juridique et écoute citoyenne pour être pleinement légitime dans un État de droit démocratique.
⚖️ Dissertation type n°2 : Le juge administratif est-il un protecteur des libertés fondamentales ?
📝 Introduction
Accroche : Longtemps considéré comme le bras armé de l’administration, le juge administratif a progressivement affirmé son rôle de garant des libertés.
Définitions :
- Le juge administratif contrôle la légalité des actes de l’administration.
- Les libertés fondamentales sont les droits essentiels reconnus par la Constitution, la CEDH ou les principes généraux du droit.
Problématique : Peut-on considérer que le juge administratif protège pleinement les libertés, ou reste-t-il trop prudent vis-à-vis de l’administration ?
Annonce du plan : Si le juge administratif s’est affirmé comme un défenseur des droits (I), sa protection demeure parfois limitée dans certains domaines sensibles (II).
✅ I. Le juge administratif, garant des libertés fondamentales
A. L’élargissement des contrôles
- CE, 1933, Benjamin : contrôle de proportionnalité des mesures de police.
- CE, 1995, Morsang-sur-Orge : dignité humaine comme composante de l’ordre public.
B. L’invention de procédures protectrices
- Référé-liberté (CE, 2001, Commune de Venelles).
- QPC devant le Conseil constitutionnel via le juge administratif.
⚠️ II. Une protection parfois timide ou limitée
A. Les domaines sensibles (ordre public, sécurité nationale)
- CE, 2021, Grande-Synthe : contentieux climatique encore timide.
- Décisions de reconduite à la frontière ou de couvre-feu examinées avec retenue.
B. Des contraintes structurelles et culturelles
- Le juge administratif reste lié à la tradition de protection de l’État, parfois au détriment de l’individu.
🧾 Conclusion
Le juge administratif a indéniablement renforcé sa mission de protection des libertés, mais son rôle reste à renforcer dans les domaines sensibles. Son équilibre entre intérêt général et droits individuels en fait un acteur clé mais parfois hésitant de la justice administrative.
Voici une dissertation type rédigée sur un sujet à cas particulier, c’est-à-dire un sujet qui semble simple mais qui cache un piège méthodologique ou une complexité doctrinale. C’est typiquement le genre de sujet donné en examen pour tester la capacité d’analyse fine du candidat.
⚖️ Sujet : L’intérêt général justifie-t-il toute action de l’administration ?
📝 Introduction
Accroche : L’action de l’administration se fonde historiquement sur la poursuite de l’intérêt général, présenté comme la raison d’être de l’État. Mais cette notion, aussi fondamentale que floue, suscite autant d’adhésion que d’ambiguïtés.
Définitions :
- L’intérêt général est une notion cardinale du droit administratif, désignant ce qui est utile ou bénéfique à la collectivité dans son ensemble.
- Il est distinct des intérêts particuliers, mais n’est défini ni par la loi, ni par la jurisprudence de manière rigide.
- L’action administrative comprend tous les actes, décisions, et politiques publiques mises en œuvre par l’administration pour atteindre ses objectifs.
Problématique : Si l’intérêt général légitime souvent l’action administrative, cette justification peut-elle tout excuser ? Ne faut-il pas poser des limites juridiques à son invocation ?
Annonce du plan : Si l’intérêt général est un fondement central et nécessaire de l’action administrative (I), il ne saurait être une justification absolue, car son invocation est encadrée par le droit (II).
✅ I. L’intérêt général : fondement traditionnel et moteur de l’action administrative
A. Une notion au cœur du service public
- La jurisprudence considère le service public comme l’expression de l’intérêt général (TC, 1873, Blanco).
- L’administration agit pour garantir continuité, égalité, adaptabilité du service public.
- CE, 1950, Dehaene : conciliation du droit de grève et de la continuité du service.
B. Justification d’actions et de prérogatives dérogatoires au droit commun
- Pouvoirs de police administrative (sécurité, tranquillité publique…)
- Expropriations pour cause d’utilité publique (ex : aménagements urbains)
- CE, 1959, Société Les Films Lutetia : le maire peut interdire une projection contraire à la moralité publique.
⚠️ II. Une justification qui connaît des limites juridiques strictes
A. L’encadrement juridictionnel de l’invocation de l’intérêt général
- L’administration ne peut agir au mépris de la légalité, même au nom de l’intérêt général.
- CE, 1933, Benjamin : nécessité d’un contrôle de proportionnalité des mesures de police.
B. L’interprétation subjective et évolutive de la notion d’intérêt général
- Le juge vérifie si l’intérêt général est réel, pertinent et conforme à la loi.
- CE, 2020, Commune de Chalon-sur-Saône : l’intérêt général ne justifie pas tout, surtout s’il entre en conflit avec des droits fondamentaux (liberté de conscience, égalité…).
C. Risques d’abus ou de détournement de l’intérêt général
- CE, 1997, Million et Marais : le respect du droit de la concurrence comme limite.
- L’intérêt général ne doit pas masquer un intérêt politique ou économique particulier.
🧾 Conclusion
L’intérêt général est un pilier fondamental de l’action administrative, lui donnant sens, légitimité et finalité. Toutefois, sa portée doit être encadrée pour éviter tout excès ou dérive. La jurisprudence veille à ce que son invocation ne serve pas de prétexte juridique, mais s’appuie sur une analyse rigoureuse et équilibrée, en respect des droits fondamentaux et de la légalité.
Pourquoi ce sujet est un cas particulier ?
Ce sujet piège souvent les candidats qui se contentent de vanter l’intérêt général sans remettre en question sa portée. Il exige :
- Une réflexion critique,
- Des références jurisprudentielles fines,
- Une mise en tension entre efficacité administrative et encadrement juridique.